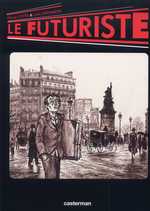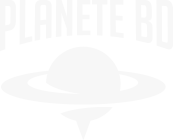L'histoire :
En juillet 1912, Marie s’installe à Paris avec son amoureux, l’artiste peintre italien Luciano Salvatori, en dépit des recommandations de ses parents, des terriens méfiants et pragmatiques. Le couple vit sous les toits, dans un total dénuement… et Salvatori s’en fiche comme de l’an 40 : seul compte l’art. L’abnégation dont fait preuve Marie à l’endroit des besoins créateurs de son compagnon, ne suffisent guère à faire rentrer l’argent. En outre, l’artiste est prompt à dépenser le moindre sou glané, en beuveries : cela l’aide « à trouver sa muse ». Néanmoins, dans ces moments de débauche il côtoie du beau monde : Apollinaire, Picasso… Avec eux, il réinvente le monde, la révolution, la nécessité de (se) détruire pour (se) reconstruire et ainsi avancer. Les galeristes boudent néanmoins ses nus, montrant une technique assurée, mais trop quelconques sur le marché. Et puis un soir, Salvatori rencontre un curieux mécène, doté d’un accent slave. Ce dernier lui passe une commande incroyablement généreuse ! Il s’agit d’inventer la guerre du futur, les machines de destruction les plus imaginatives, d’un point de vue artistique. Salvatori signe le contrat (sur le dos d’un bossu) sans trop réfléchir, d’autant plus que la destruction participe de son idéal révolutionnaire. Une seconde plus tard, il se blesse avec une coupe de champagne et quelques gouttes de son sang atterrissent sur le contrat…
Ce qu'on en pense sur la planète BD :
Au départ, on pénètre dans un récit historique, entre chronique sociale et quête de muse, à l’époque des avant-gardes artistiques du début du XXe siècle. Le scénario d’Olivier Cotte nous présente alors un « héros » pas franchement sympa. Salvatori côtoie certes les grands de l’art, mais il reste un petit, dont les frustrations nourrissent les idées révolutionnaires. Certainement talentueux, cet anti héros insiste et se complet dans une voie où il n’est pas reconnu et – surtout – dans la débauche intime qui l’accompagne. Le tendre personnage de Marie, animée d’un désir maternel commun, n’apparait dès lors plus que comme le révélateur de cette mentalité égoïste. Au dessin, Jules Stromboni livre des planches parfaitement adaptées à l’ambiance sordide, s’appuyant en cela sur une monochromie qui ajoute à la fois un aspect suranné à l’histoire et se fait caisse de résonnance au total dénuement du couple. En marge de cette présentation, le récit emprunte une dimension faustienne évidente. Notre héros négatif commence en effet à honorer un pacte diabolique (signé de son sang), qui l’amène à inventer la guerre du futur… au moment même où débute la première guerre mondiale. La débauche de vie devient alors déviance humaine, la jouissance de la puissance armée excite ses sens, en guise d’écho freudien… Et le lecteur de s’interroger sur le rapport que peut entretenir l’art, procédé intimement créateur, et la guerre, aux fins uniquement destructrices. L’art peut-il donc tuer ? L’ambition de ce one-shot est dûment atteinte et finement jouée.