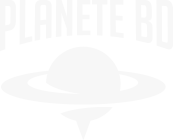L'histoire :
Julio nait en 1900, au sein d’une famille de petits paysans d’Amérique latine, dans un hameau isolé. Or dès les premiers jours, la famille panique car le bébé est introuvable. C’est son oncle Juan qui le retrouve indemne, après qu’il a roulé tout en bas d’une butte à quelque distance des maisons. Sofia, la sœur de Julio, se méfie de Juan, dont elle perçoit l’âme sombre : elle se doute que c’est lui qui a jeté le bébé dans le ravin. Sans doute pour paraître en sauveur devant les siens. Secrètement amoureuse d’un garçon parfois en proie à des crises de folie, Sofia s’occupe dès lors plus affectueusement de son petit frère. Julio est plutôt tendre, ce qui lui faut d’être chahuté à l’école par les garçons plus forts que lui. Un jour, le père de Julio doit effectuer un voyage de quelques jours à pied. Il lui arrive alors une curieuse mésaventure. Tout d’abord, il glisse sur une coulée de boue et dévale douloureusement du haut d’une falaise. Il se relève sans rien de cassé, mais plus tard, lorsqu’il croque enfin dans le sandwich que lui a préparé sa femme, il s’aperçoit trop tard qu’il est infesté de vers bleus. Particulièrement toxiques, ces vers génèrent une réaction spectaculaire sur son métabolisme, alors qu’il est esseulé en pleine nature : œdème généralisé fulgurant, langue qui gonfle, yeux qui saignent…
Ce qu'on en pense sur la planète BD :
En préface, l’écrivain américain Brian Everson replace la démarche de ce roman graphique « indé » réalisé par Gilbert Hernandez, plus connu pour sa saga Love and Rockets qu'il réalise avec son frère Jaime. Everson souligne : l’histoire de Julio fait écho à la futilité de l’existence éphémère, l’un des axes majeurs de l’œuvre de Samuel Beckett. Effectivement, dès la première case, Julio apparait du néant (le noir à l’intérieur de sa bouche, lors de son premier cri, en travelling arrière) et retourne, précisément 100 pages et 100 ans plus tard, au néant noir (travelling avant sur l’intérieur de son dernier râle). Entre temps, nous suivons par courtes bribes fragmentées et indépendantes le destin ordinaire d’une famille chiche de paysans « mexicains »… quoique que le cadre géographique ne sera jamais spécifié. On perçoit en revanche à distance le cours du temps et les mutations sociétales, tout au long du XXème siècle. Pour le reste, à travers sa narration minimaliste, Hernandez en dit toujours un minimum. Il laisse les événements se produire (maladies, marasmes, coups du sort, guerres…), négligeant la plupart du temps – à dessein – les causes et les conséquences, tout autant que la finalité des faits. Culotté, ce parti-pris fait sens : il renforce le propos nihiliste et le détachement vis-à-vis des personnages… Néanmoins, sur le plan séquentiel, Hernandez use et abuse de son art consommé pour l’épure graphique et l’ellipse narrative. Tantôt l’effet produit est tout à fait pertinent, tantôt il se montre vraiment borderline dans la transmission du récit. Une certaine propension à plus focaliser sur les drames, les enterrements, le sordide, que sur les moments de bonheur – qui sont pourtant aussi une composante intrinsèque d’une vie ! – renforce l’austérité de ce one-shot et l’axe définitivement dans son ambiance atrabilaire…