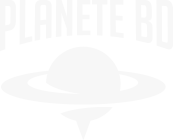Depuis 4 tomes déjà, Fabien Nury et Sylvain Vallée ne cessent de sonder les contradictions propres au parcours de Joseph Joanovici, juif collabo qui s’est enrichi pendant l’Occupation au cours de la Seconde Guerre mondiale. Succès public et critique, auréolé du prix de la meilleure série au dernier festival d’Angoulême, Il était une fois en France est une saga mafieuse à la française, bâtie « en cinémascope ». Planetebd avait envie de se pencher sur le phénomène en allant à la rencontre de son dessinateur, Sylvain Vallée. C’est parti…
interview Bande dessinée
Sylvain Vallée
 Bonjour Sylvain ! En quelques mots, peux-tu d’abord te présenter et nous dire comment tu en es venu à faire de la bande dessinée ?
Bonjour Sylvain ! En quelques mots, peux-tu d’abord te présenter et nous dire comment tu en es venu à faire de la bande dessinée ?Sylvain Vallée : C’est une vieille histoire, une histoire un peu triste d’ailleurs, qui commence mal, mais qui finit bien. Gamin, j’ai passé un mois et demi dans un hôpital, j’ai été hospitalisé pour une raison grave et ma mère venait tous les jours avec un album de bande dessinée me lire les planches. C’était Astérix à l’époque, et elle faisait les voix des personnages en même temps. Et le lendemain, puis les autres jours, elle revenait avec d’autres BD. Quand on a 5 ans et demi, et que chaque jour on s’accroche à une BD, ça crée quelque chose en vous, une vocation. Je crois que je me suis beaucoup raccroché à ça, en fait. Et puis vers 7, 8 ans, je continuais à lire beaucoup de bandes dessinées évidemment, et je me suis dit que c’était quelque chose que j’avais vraiment envie de faire. Et puis j’ai beaucoup, beaucoup dessiné, je n’ai jamais lâché le crayon. Faire de la bande dessinée, c’était réaliser un de mes rêves.
A quel âge as-tu commencé à dessiner ?
SV : Assez tôt, dès 6 ans. Ensuite, là où à 15, 16 ans certains commencent à lâcher le crayon parce que les retours des copains ou de la famille sont négatifs, moi, j’avais le sentiment a priori que mes dessins étaient plutôt pas mal. J’avais des compliments et j’ai donc continué. C’est ça qui m’a encouragé. Ma famille, d’ailleurs, ne s’est jamais opposée à cette idée d’en faire ma profession.
Quand as-tu décidé de faire de la BD professionnellement ?
SV : Quand j’ai décidé de faire l’école Saint Luc à Bruxelles, après le lycée. Ça s’est décanté au lycée, en fait, je côtoyais déjà des professionnels, j’allais dans des festivals, je faisais la pêche aux dédicaces. A 16, 17 ans, je faisais mes propres fanzines et je les vendais sur les festivals. Un parcours quasi évident, lors duquel je suis passé par toutes les étapes.
 Est-ce difficile d’entrer dans le monde de la BD ?
Est-ce difficile d’entrer dans le monde de la BD ?SV : Pour moi ça ne l’a pas été, parce qu’il y avait cette évidence très jeune. D’où l’énergie pour monter des dossiers, montrer mon boulot à des professionnels, envoyer des projets aux éditeurs. J’ai tout essayé, c’était ça la vocation.
Pour Il était une fois en France, comment s’est passée la rencontre avec Fabien Nury ?
SV : Ça s’est fait par le biais de Laurent Müller – rendons à César ce qui est à César – éditeur chez Glénat à l’époque, avec lequel je travaillais pour Gil Saint-André. Il savait que j’avais envie de traiter différemment la Seconde Guerre mondiale, précisément l’occupation. C’est une époque qui peuplait mon imaginaire grâce aux films des années 50, 60, Laurent le savait. Un jour, il m’envoie un manuscrit de 120 pages, présentant le traitement global d’une histoire, non découpée, en partie dialoguée. L’histoire, c’est celle du destin de Josef Joanovici. Je connaissais vaguement son nom, son rôle de collabo lambda, et je ne m’étais jamais vraiment intéressé au personnage. Quand j’ai commencé les recherches et après avoir terminé la lecture du scénario de Fabien Nury, je me suis dit : c’est super, le dessin est passionnant, le scénario est excellent, mais où est la part de vérité là-dedans ? Je me suis posé la question que tous les lecteurs se posent maintenant. En lisant les bouquins que Fabien m’a proposés, je me suis rendu compte que beaucoup de choses étaient authentiques, vraies. Le défi résidait alors dans la manière de présenter les faits historiques. Comment les rendre attrayants dans la structure scénaristique ? Je ne connaissais pas plus que ça Fabien Nury. Alors pour démarrer une collaboration de 6, 7 ans sur un projet de ce genre, avec une personne qu’on ne connaît pas, vous avez deux options : soit on prend un an ou deux pour apprendre à se connaître, à se jauger, à voir où on peut aller ensemble, à définir le terrain de jeu commun. Soit on va prendre 10 cuites sur un mois, on se fout tous les deux à poil et on apprend à connaître l’autre. C’est la deuxième option qu’on a choisit (rires). Des soirées pendant lesquelles on s’est raconté notre vie, nos envies, on a rattrapé le temps perdu. On a été au diapason rapidement, ce qui a clairement facilité le travail.

Comment s’est passée ton approche graphique ?
SV : Au départ, on se dit qu’on a besoin d’un dessin réaliste, adaptable, et finalement assez académique. Et là je me suis dit non, je vais profiter de cette série pour avoir plutôt une approche caricaturale sur un fond réaliste. Pour l’avoir fait avant, je savais que ça marchait. J’avais envie de renouer avec ce décalage là et je pense que si la série est attrayante, c’est en partie
 en raison de cette distorsion entre le traitement graphique, caricatural, et la trame scénaristique, réaliste. Et évidemment, la qualité du scénario. Un réalisme pur, froid, rigide, nous aurait sclérosés graphiquement, le réalisme limitant la variété d’expressions. Le terrain de jeu en termes d’émotion et d’expressivité devait être le plus large possible. Donc ce choix de jouer sur l’expressionnisme des personnages de manière très forte : les détails des corps sont réalistes, la mise en scène l’est, mais du point de vue de la résolution graphique, des visages notamment, la caricature paraissait le plus intéressant. Pour la BD, la caricature ne m’est pas utile au sens satirique, mais plutôt en termes d’expressivité. Je ne souhaitais pas utiliser la caricature pour dénoncer, critiquer : je voulais une caricature expressionniste qui ne tombe pas dans l’écueil de la satire, sachant qu’on a un sujet ultra ambigu et qu’on ne peut pas se permettre non plus d’avoir un propos ambigu. Il fallait être donc très clair. La caricature m’a permis de rendre vivants et authentiques mes personnages.
en raison de cette distorsion entre le traitement graphique, caricatural, et la trame scénaristique, réaliste. Et évidemment, la qualité du scénario. Un réalisme pur, froid, rigide, nous aurait sclérosés graphiquement, le réalisme limitant la variété d’expressions. Le terrain de jeu en termes d’émotion et d’expressivité devait être le plus large possible. Donc ce choix de jouer sur l’expressionnisme des personnages de manière très forte : les détails des corps sont réalistes, la mise en scène l’est, mais du point de vue de la résolution graphique, des visages notamment, la caricature paraissait le plus intéressant. Pour la BD, la caricature ne m’est pas utile au sens satirique, mais plutôt en termes d’expressivité. Je ne souhaitais pas utiliser la caricature pour dénoncer, critiquer : je voulais une caricature expressionniste qui ne tombe pas dans l’écueil de la satire, sachant qu’on a un sujet ultra ambigu et qu’on ne peut pas se permettre non plus d’avoir un propos ambigu. Il fallait être donc très clair. La caricature m’a permis de rendre vivants et authentiques mes personnages.Graphiquement, qu’est ce qui t’a posé problème ?
SV : Ce qui m’a pesé pendant un temps, c’est de trouver le bon réglage par rapport notamment à Gil Saint André. Il m’a fallu m’en détacher, et m’imprégner de l’histoire de Joanovici. Je dirais qu’après deux tomes, j’avais trouvé le bon équilibre. Pour le troisième, c’était réglé.

Est-ce que Fabien te laisse une marge de manœuvre ?
SV : Dès le départ, j’avais un script très complet, raison pour laquelle d’ailleurs j’ai tout de suite signé. Un manuscrit de 120 pages, qui me permettait de savoir parfaitement où j’allais m’engager. Moi, je ne peux pas m’engager sur une promesse. On passe trop de temps sur nos planches, sur nos albums, un échange agréable ne suffit pas. Il faut écrire pour savoir ce que les histoires deviendront. J’ai donc une base complète, même si le scénario est appelé à évoluer dans le travail commun, dans la réécriture des dialogues notamment. Globalement, c’est tellement une bonne came au départ que ma marge de manœuvre n’est finalement pas énorme. En revanche, il fallait bien définir notre terrain de jeu commun, celui de la mise en scène, dans le sens où après la lecture du scénario, je lui fournis un storyboard très poussé qui est quasiment un crayonné avec le jeu des acteurs. Ça permet à Fabien de régler le curseur en termes d’intensité. Là commence notre discussion, notre travail en commun. Il faut être dans l’intensité et dans l’intention, c’est peut-être un de mes écueils, le manque d’intensité ou un dessin pas assez démonstratif. Clairement, je ne viens pas de l’école des comics et ça se voit. Ce que j’aime surtout, c’est avoir une lecture entre les lignes du scénario. Là, je prends mon plaisir, je m’amuse. Ce qui m’intéresse, c’est savoir exprimer l’ellipse, le non-dit. C’est le non représenté que j’ai envie de raconter.
Combien de temps mets-tu pour la réalisation d’un album ?
SV : 8 à 10 mois à peu près, couleur incluse (1 mois et demi). Je fais très attention à la couleur. Je travaille sur du A3, je fais les 15 premières planches, et une fois qu’elles sont validées, je fais les encrages et le reste.
 Qu’est ce que tu penses de ton personnage Joanovici, ce juif collabo au comportement pour le moins ambigu ?
Qu’est ce que tu penses de ton personnage Joanovici, ce juif collabo au comportement pour le moins ambigu ?SV : Je pense la même chose que ce que pense le lecteur : je n’ai jamais d’idée définitive sur le personnage. Ce qu’on fait avec Fabien, c’est un travail de présentation à partir de tous les éléments récoltés. La vraie question, c’est de savoir comment on allait présenter ça. Alphonse Boudard, par exemple, dans L'étrange Monsieur Joseph, en fait un héros. C’est un très bon livre pour découvrir le personnage, sauf qu’il le dédouane. Un moment, t’en lis un autre : le bouquin te présente le collabo pourri. Alors moi, qu’est-ce que je raconte, quand t’as lu tout et son contraire ? Fabien a donc choisi de maximiser le paradoxe et d’aller à fond dans cette direction. On ne cherche pas à juger, mais à présenter les choses en maximisant l’ambiguïté. Dans le dessin, j’essaye de faire ça aussi : je sais que mon personnage est parfois touchant, il a une tête de maquignon, il est finalement plutôt sympathique, hâbleur, brillant orateur. Il a ce côté extrêmement séduisant, touchant, mais aussi extrêmement manipulateur. Donc dans le dessin, il faut que je trouve un réglage à chaque fois qui me permette de le faire basculer de l’un à l’autre. Ça se joue à peu de choses : un sourcil osé, un œil plus ouvert, plus perçant, plus profond, un placement de pupille. D’où la précision du trait crayonné que vous voyez là. J’ai choisi un mode simple et accessible de représentation : ligne claire, couleur directe, pas de contemplation. Le propos est lourd, parfois difficile à traiter, il faut donc que le véhicule soit confortable pour emmener le lecteur vers des choses peut-être difficiles à lire. Tant que je n’aurai pas vécu tous les moments de dessin, je ne pourrai pas me faire une idée définitive du personnage. Evidemment on le sait, c’est un salaud. On essaye simplement d’expliquer pourquoi il est devenu un salopard. Rien n’excuse son comportement aussi, c’est toute l’ambiguïté et le charme de Joanovici.
Est-ce que le succès public, et même critique, change ton regard sur la BD et ta manière de l’appréhender ?
SV : Ça m’a donné beaucoup de réponses. Un auteur fait un parcours, se cherche, essaye plein de trucs, et petit à petit on définit ce qui fait notre style. Et même au-delà, ce qui définit notre amour pour la BD. Plus j’avance, plus je me rends compte que le style n’a pas d’importance. Je ne suis pas dessinateur. Je suis ra-con-teur d’histoires. Mon terrain de jeu, c’est l’interaction avec Fabien, ce ping-pong, ce dialogue permanent. Finaliser les planches à l’encrage me plait 100 fois moins que cette interactivité avec Fabien. Et demain, je vais faire une autre série, je changerai de style. Parce que le propos l’imposera ou parce que ma vision ou mon regard sur le scénario sera différent. Par exemple, en ce moment, je pose les bases d’un XIII Mystery avec Joël Callède. Je ne peux pas dessiner à la façon d’Il était une fois en France. Le prochain projet avec Fabien aura aussi un autre style. Mon plaisir n’est finalement pas dans la résolution technique ou graphique pure, mais plutôt dans la fidélité de restitution d’une histoire authentique.
Si tu avais le pouvoir cosmique de visiter le crâne d’un autre auteur pour mieux le connaître, qui irais-tu visiter ?
SV : Moi, dans 10 ans ou 20 ans !
Merci Sylvain !